Pour notre marquis il n'y avait pas dans ses théories paysagères que de l'esthétique ; il leur attribuait tout un rôle économique et social : Embellir la nature, c'était pour lui mêler l'utile à l'agréable. On commençait alors à goûter le pittoresque des lieux sauvages, et le « Désert » d'Ermenonville est un de ces endroits où les Français du XVIII° siècle s'aperçurent que certains détails de la campagne brute et inculte, pourraient émouvoir l'âme et même la charmer pendant quelque temps. Mais nos aïeux ne se sentaient pas encore des goûts d'ermites, et ils préféraient découvrir de leurs fenêtres les aspects riants d'une campagne fertile. Aussi embellir toutes les campagnes de France, c'était pour Girardin y créer toute la prospérité agricole de celles d'Angleterre. Il souhaitait ardemment voir tous les seigneurs revenir dans leurs terres, se consacrer à leur amélioration, s'efforcer de procurer l'aisance et la vie heureuse à leurs vassaux, par les richesses de l'agriculture. Le dernier chapitre de son petit livre est intitulé :
« Des moyens de réunir l'agréable à l'utile, relativement à l'arrangement général des campagnes ; but principal de tout cet ouvrage. »
Il commençait ainsi son chapitre (2) : « C'est surtout dans une florissante végétation que consiste le principal agrément d'un paysage autour d'une habitation ; et comme je l'ai déjà dit tant de fois, si l'on veut se procurer une véritable jouissance, il faut toujours chercher les moyens les plus simples, et les agréments les plus conformes à la nature, parce qu'il n'y a que ceux-là de véritables et dont l'effet soit sûr à la longue.
« La substitution de l'arrangement le plus naturel à l'arrangement le plus forcé doit donc en ramenant enfin les hommes au vrai goût de la belle nature, contribuer bientôt à l'accroissement de la végétation ; et par conséquent aux progrès de l'agriculture, à la multiplication des bestiaux; mais surtout à un arrangement plus salutaire et plus humain dans les campagnes, en assurant la subsistance des bras qui nourrissent les têtes dont les occupations réfléchies doivent servir à défendre ou à instruire le corps de la société.
« L'homme de bien, rendu à un air plus pur, et ramené dans les campagnes par les véritables jouissances de la nature, sentira bientôt que la souffrance de ses semblables est le spectacle le plus douloureux pour l'humanité ; s'il commence par des paysages pittoresques qui charment les yeux, il cherchera bientôt à former des paysages philosophiques qui charment l'âme ; car le spectacle le plus doux et le plus touchant est celui d'une aisance et d'un contentement universels.»
Quelle ferveur dans le « philosophisme » de ce noble idéologue ; le ton avec lequel il parle des « véritables jouissances de la nature », de « la souffrance de ses semblables, spectacle le plus douloureux », n'est-il pas celui d'un des premiers adeptes de la religion de l'humanité ?
Mais quels moyens pratiques a-t-il préconisés pour procurer tout ce perfectionnement, ou plutôt toute cette réforme agricole et sociale ? Nous allons résumer brièvement les développements de son chapitre, laissant au lecteur la faculté de juger la valeur de ses remèdes pour les maladies de l'Ancien Régime.
Il considérait comme nécessaire que tout paysan fût un petit cultivateur, installé au milieu de ses terres, et il demandait qu'une loi de « compact » substituât « l'arrangement le plus naturel à l'arrangement le plus forcé ». Par des échanges heureux, on obtiendrait la contiguïté de toutes les terres du même laboureur. Ce serait une transformation radicale de l'agriculture.
Il voulait aussi que les pâtures communes fussent au milieu des villages. C'aurait été des places d'agrément pour la promenade et les jeux des paysans : « Les habitants n'auroient qu'à ouvrir leurs portes, pour y laisser en liberté leurs bestiaux, sans avoir besoin, ni de pâtres, ni de chiens pour les garder et les tourmenter. La pauvre mère de famille, en filant sur le pas de sa porte, aurait du moins la consolation de voir jouer ses plus jeunes enfants autour d'elle, tandis que sa vache, son unique possession pâturerait tranquillement sur un beau tapis de verdure qui lui appartiendrait ; cette vue de sa propriété l'attacherait à son pays et lui ferait trouver plus pur l'air qu'elle y respire. Ces sortes de « places », même en Angleterre sont le plus agréable de tous les « jardins anglais » ; jusqu'aux animaux tout y paraît content. »
Girardin réclamait avec énergie, la grande réforme tentée par Turgot : la liberté du commerce des grains. Enfin pour couronner ces réformes, il n'hésitait pas à demander que la loi imposât également aux propriétaires l'obligation d'affermer en détail toutes leurs terres, afin que tout paysan puisse trouver travail et subsistance, critiquant amèrement la mode des grosses fermes.
« L'effet de cette disposition, écrivait-il, serait sans doute de se rapprocher dans l'ordre civil autant qu'il est possible de l'ordre naturel, par une plus grande facilité dans la culture et par une plus égale distribution de fruits de la terre. Alors plus il y aurait de cultivateurs, moins il y aurait de journaliers, le prix de leur journée augmenterait donc nécessairement par la diminution de leur nombre. Plus il y aurait de cultivateurs, plus il y aurait de concurrence, par conséquent moins de monopole ; le véritable prix des denrées comparativement à leur rareté, ou à leur abondance effective se rétablirait donc nécessairement par l'abondance du nombre des vendeurs moins opulents et la diminution d'acheteurs moins indigents. D'ailleurs les habitants de campagne garderaient d'abord leur propre subsistance, et se trouveraient intéressés à la plus grande valeur de leur excédent ; c'est alors que la liberté du commerce des grains pourrait s'établir sans la résistance de cette loi antérieure à toute argumentation et à toute convention humaine : la nécessité que tout ce qui respire soit nourri. »
Mélange curieux de rêveries et d'idées économiques assez précises, qui se terminait par le souhait de voir toutes les campagnes transformées en immenses parcs anglais aussi délicieux pour le cœur que pour les yeux.
D'aucuns diront : Tout cela est fort bien ; mais notre philosophe a-t-il commencé par appliquer ses théories, pour tout ce qui dépendait de son initiative personnelle ?
Il semble bien que oui. Il avait d'abord remarquablement transformé Ermenonville au point de vue agricole. Ses jardins étaient d'un bon revenu. Son moulin tournait activement toute l'année ; des bestiaux superbes étaient le principal ornement de ses prés ; ses eaux étaient poissonneuses. C'était, semble-t-il, un homme fort entendu en affaires. Ses papiers nous montrent un excellent maître de maison, et un administrateur de domaines ruraux, minutieux et de grand sens. Si tous les grands seigneurs s'étaient, comme lui et quelques-uns de ses contemporains, également préoccupés des améliorations de leurs terres, le développement agricole qui fut réel dans la seconde moitié du XVIII° siècle aurait atteint des proportions intéressantes, et aurait peut-être atténué la crise de l'Ancien Régime.
Mais il était précisément le propriétaire d'une de ces grosses fermes, qu'il critiquait si bien. Son intention fut de la morceler ; il semble même qu'il le fit avant la Révolution. Une note de la description d'Ermenonville publiée chez Mérigot, parle de différents enclos établis dans la plaine autour du village, pour constituer de petites métairies. Le seigneur philosophe en faisait des prix de vertu pour les plus méritants de ses paysans. Il avait établi, en outre, « un prix d'encouragement pour augmenter l'émulation et tâcher par des essais sur l'agriculture d'approcher des Anglais dans un art qu'ils ont si fort perfectionné ».
Peut-être, les habitants ne lui surent-ils pas beaucoup de gré de ses idées sociales, mais il en est souvent ainsi pour beaucoup de philanthropes. La Révolution cependant lui rendit hommage, et nous verrons qu'emprisonné pour l'imperfection de son « civisme » il fut relâché parce que sa présence fut reconnue nécessaire à la prospérité d'Ermenonville (3).
C'était un vrai philosophe, au sens que ce mot avait couramment au XVIII° siècle ; on le peut expliquer par cette définition : le philosophe était un homme réglant sur les lumières de sa raison, sans se préoccuper des traditions, ou plutôt, pour parler comme les gens de ce temps, des préjugés. Pour Girardin en particulier et pour les « Philosophes », l'aliment de ce « flambeau de la Raison » qui les éclairait tous, c'était en somme les sciences, du monde physique comme du monde moral. Elles n'étaient pas très avancées, mais on leur attribuait déjà une énorme valeur, et pour exprimer ce tour d'esprit avec plus de précision, c'était quelque chose d'analogue, toutes différences admises à la Science avec un grand S, dont il y a trente ans parlaient les contemporains de Taine et de Renan. Une note de Girardin, dans ses plans et dessins manuscrits pour la création d'Ermenonville est très suggestive pour expliquer les conceptions de nos aïeux, et le sens qu'ils donnaient au mot philosophie.

Le petit temple en ruines ou plutôt inachevé qui domine encore l'étang d'Ermenonville s'appelait : « Temple de la Philosophie moderne. » Profond symbole ; inachevé il représentait justement ces lumières de la Raison, cet édifice des connaissances humaines, auquel chaque penseur et chaque savant apporte sa pierre. Les plus grands sont les colonnes du temple ; et quels étaient-ils suivant Girardin ? leur choix est amusant et significatif : - Newton, avec cette devise : Lucem ; - Descartes : Nil in rebus inane ; - Voltaire: Ridiculum ; - W. Penn : Humanitatem (oui, W. Penn le fondateur des Quakers, qui n'ôtaient jamais leurs chapeaux); - Montesquieu : Justiciam ; - et enfin le plus grand, le plus cher au cœur de Girardin, J.-J. Rousseau : Naturam, sans parler de Montaigne à qui le temple lui-même était dédié.
C'étaient donc les grands hommes, qui selon le propriétaire d'Ermenonville, avaient le plus contribué à l'avancement des sciences et à la destruction des préjugés. Le guide des jardins disait avec orgueil, qu'il était plus facile d'obtenir un fauteuil à l'Académie qu'une colonne à Ermenonville, bien que des fûts couverts de mousse attendissent et attendent toujours d'être érigés en l'honneur des continuateurs du grand œuvre de la civilisation.
Le choix des philosophes honorés d'une colonne nous paraît un peu fantaisiste, car s'il ne faut pas s'étonner que saint Thomas, Pascal ou Malebranche n'en fussent pas, Girardin aurait pu songer à Bacon, à Keppler, à Galilée, etc., voire même à Gutenberg. En effet voici le début de la note marginale écrite par Girardin sur le plan de son temple : « La philosophie ancienne était bornée à la morale ; la philosophie moderne y réunit les avantages de la physique et de l'imprimerie qui communique les idées... » Cette note montre qu'il n'est pas hors de propos de dire que la « Philosophie » pour nos aïeux de 1770 était quelque chose d'analogue à la « Science » du XIX° siècle, le développement des connaissances et la conquête des choses par l'industrie humaine, dont le résultat final doit être le bonheur de l'humanité.
Aussi Girardin lui-même travaillait-il à l'œuvre philosophique en s'occupant avec beaucoup de goût de sciences. Il publia dans le Journal de physique de Rozier des « Observations sur les Eudiomètres ».
C'était avec un grand enthousiasme qu'il voyait le bonheur futur de l'humanité par la Philosophie. C'était un rêveur froid, mais un grand rêveur, en somme un idéologue parfait : il s'était composé une doctrine fixe, certaines directions générales dont il ne voulut jamais démordre. Sa confiance en sa « Philosophie » était une véritable foi : rien ne pouvait contredire ses idées préconçues, mais il trouvait en toutes choses des arguments en leur faveur.
Il avait deux auteurs favoris, l'un contemporain, J.-J. Rousseau, l'autre ancien, Montaigne. Aussi ai-je pu feuilleter les Essais, et le Contrat Social, le Discours sur la constitution de Pologne annotés de sa main. C'étaient ses bréviaires : il avait marqué un certain nombre de pensées en conformité avec ses idées, sur des sujets divers, et une petite liste de rubriques, sur la couverture des livres, renvoie aux pages qui contiennent ces pensées. Il se formait ainsi un petit dictionnaire philosophique par extraits de Montaigne et de Rousseau, prenant naturellement dans leurs œuvres tout ce qui était à l'appui de ses idées personnelles.
Il prisait fort Montaigne. On lit quelque part dans les Essais : « Ce n'est pas raison que l'art gaigne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère Nature. Nous avons tant rechargé la beauté intrinsèque et richesse de ses ouvrages par nos inventions, que nous l'avons du tout étouffée ; n'est-ce que partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. »
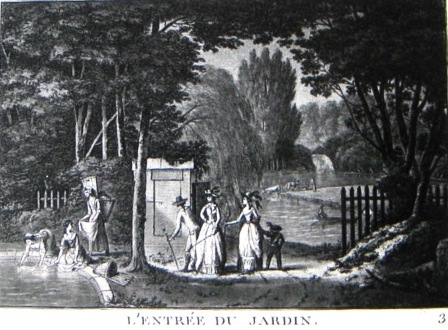
C'était la devise d'Ermenonville ; l'inscription liminaire qui attendait les promeneurs à l'entrée des jardins. En outre dans le temple de la « Philosophie moderne » ainsi qu'il a déjà été indiqué, au-dessus de l'autel des sacrifices sont encore gravés ces mots : « Hoc templum inchoatum Philosophiae nondum perfectae, Michaeli Montaigne, qui omnia dixit, sacrum esto. »
Dans les Essais annotés, au mot Science, on est renvoyé à ce passage : « C'est une bonne drogue que la science, mais nulle drogue n'est assez forte pour se préserver sans altération et corruption selon le vice du vase qui l'estuye. » Au mot : croyance on trouve également une satire des superstitions, au mot liberté cette constatation qu'il est des peuples incapables d'en jouir, etc.
Il dut considérer encore plus Rousseau comme un maître, surtout au point de vue politique. S'il n'accepta pas tout Rousseau pour constituer son bréviaire (et c'eût été difficile, à moins d'être aussi contradictoire que le bon Jean-Jacques, et Girardin était tout l'opposé), du moins il trouva dans les écrits de Rousseau, des formules pour toutes ses idées personnelles. Il fut absolument féru du Contrat Social, et il considérait la Souveraineté Populaire comme une vérité essentielle ; nous essaierons de voir plus loin à propos de son attitude sous la Révolution, comment « la volonté générale » et autres développements de Jean-Jacques étaient pour lui des principes pratiquement applicables. Il faut d'ailleurs ajouter qu'il partageait le sentiment conservateur qu'on peut facilement noter dans maints passages des écrits de Rousseau : l'horreur des brusques changements.
C'était un bon disciple de Jean-Jacques par ses idées générales, ses sentiments, son idéal. Il rêvait le retour à la Nature, et avec quelle ferveur. Mais comment se ferait ce retour à la Nature ? A ce sujet la note sur le temple de la philosophie, est encore très suggestive. Le retour à la Nature ne se ferait pas par l'abandon des Sciences et des Arts et le culte de l'ignorance ; il se séparait du Rousseau du Discours à l'Académie de Dijon : « La philosophie ancienne, disait-il dans la note déjà partiellement citée, était bornée à la morale ; la philosophie moderne y réunit les avantages de la physique et de l'imprimerie, qui communique les idées. Avec tous ces moyens réunis, c'est à elle à procurer aux hommes tout ce qui peut leur être utile et à les ramener enfin à ce bonheur qu'ils avaient reçu de la Nature. »
Il y a certainement là une curieuse interprétation du philosophe du « Retour à la Nature » ; il est piquant de se dire que les rêveries illogiques, contradictoires et utopiques que nous trouvons dans Rousseau, un homme du XVIII° siècle ne les y trouvait en aucune façon ; il comprenait tout autrement. Assurément le Rousseau, tel que nous l'interprétons généralement aujourd'hui, n'était pas fait pour le marquis de Girardin, homme aux déductions logiques, et rêveur aux espoirs tenaces dans l'avenir de l'humanité, dans ce qu'on a appelé depuis le progrès. Donc pour lui, c'était par les lumières de la philosophie, par les Sciences que l'homme comprenant ses erreurs, ses préjugés et ses égarements, reviendrait à une pure morale, à une vie familiale et sainte, non pas telle sans doute que celle des bergers de l'âge d'or, mais aussi vertueuse et excellente, et recréant enfin le bonheur sur la terre.
Cela éclaire d'un jour tout spécial les bergeries d'Ermenonville,
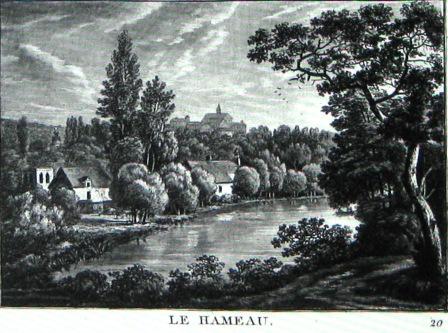
la prairie Arcadienne, scène pour Gessner, et la place des jeux des villageois.

Girardin, il faut lui rendre cette justice, s'était efforcé d'appliquer ses principes dans sa vie privée. Les visiteurs d'Ermenonville parlent sans cesse des vertus patriarcales du propriétaire, de sa simple vie familiale, entouré de quelques amis, digne d'un philosophe antique.

Arcadia,
Thomas Eakins, MET Metropolitan Museum of New York
Il eut une nombreuse famille : quatre fils et deux filles ; Stanislas, vicomte d'Ermenonville, qui sera l'homme politique éminent de la Révolution et de l'Empire ; Louis, marquis de Brégy, futur député sous la Restauration et la monarchie de Juillet ; Alexandre, le général de Girardin, grand veneur de Louis XVIII, enfin Amable, le « petit gouverneur » de Rousseau, dont nous dirons plus loin l'âme sensible et passionnée. Ses deux filles devinrent mesdames de Bohm (4) et de Vézelay (5).
A l'époque dont nous parlons, vers 1775, les aînés étaient encore de jeunes enfants, élevés à la Spartiate, par un père assez rude. Il leur laissait toutes libertés de courir dans les champs et les bois avec les enfants des villageois, mais il badinait peu et son autorité était absolue. Il fut l'un des initiateurs d'une éducation toute nouvelle, inspirée de l'Émile. Ce furent les enfants de Girardin qui révolutionnèrent le costume des jeunes nobles. Ils apparurent un jour aux Tuileries en petites vestes à l'anglaise (6); ce fut un grand scandale, mais les enfants pomponnés en culotte et bas de soie, ou robes à paniers envièrent bientôt ce simple accoutrement, qui permettait de jouer et de courir tout à l'aise. Il y eut des pétitions aux parents, et la simplicité fut rapidement mise à la mode.
Si la famille de Girardin lançait les modes anglaises dans ses séjours à Paris pendant les mois d'hiver, à plus forte raison l'été à Ermenonville, la simplicité était de règle. La marquise semble avoir partagé les goûts de son mari. Nous parlerons plus loin de ses idées philosophiques, et des quelques notes qu'elle a laissées. Les dames d'Ermenonville étaient vêtues de simples robes de drap brun, des « amazones », mode de campagne qui commençait à ce moment.
Notre philosophe était un père très rude : on raconte qu'il faisait faire à ses fils le voyage de Paris à Ermenonville pédestrement, ce qui était une douzaine de lieues, par des chemins plus pittoresques mais moins bons qu'aujourd'hui (7). Il les obligeait à gagner leur déjeuner, en grimpant à un mât de cocagne planté à cet effet dans la cour du château (8). La tradition veut aussi qu'un jour, son fils Stanislas âgé de quinze à seize ans étant à la chasse assez loin, il envoya un homme à cheval pour le prier de revenir immédiatement. Dès qu'il fut arrivé : « Monsieur vous avez oublié de fermer votre porte, lui dit-il, fermez-la et vous pourrez ensuite retourner à la chasse. »
Il donnait à ses fils des précepteurs allemands, qui leur enseignaient leur langue (pour traduire Gessner), les sciences et la musique. Il ne voulut jamais que son fils aîné apprît le latin. Pourquoi ? nous n'en savons rien. Le Premier Consul déclara plus tard à son ami Stanislas de Girardin, qu'il avait eu pour père un « f… original ». (9). Les enfants apprirent tous le dessin avec d'excellents maîtres. Chatelet et surtout l'Alsacien Frédéric Mayer, furent les commensaux du marquis, et les peintres d'Ermenonville. Sous leur direction, les enfants de Girardin dessinèrent avec beaucoup de goût. Louis, appelé marquis de Brégy, a laissé des peintures à l'huile qui ne sont pas sans valeur ; il fut plus tard élève de Bidault. Le carnet de dessin de Stanislas de Girardin nous a transmis des croquis de toutes les « fabriques » d'Ermenonville et de paysages de fantaisie tout à fait charmants (10).
Mais les premiers maîtres de ces enfants furent le curé et le magister du village qui leur donnaient des leçons en compagnie des petits paysans leurs camarades de jeux (11).
Toute la société d'Ermenonville vivait avec une charmante simplicité. Le dessin, la musique, la chasse et les promenades étaient les distractions ordinaires. On ne pouvait s'ennuyer dans l' « Elysée » d'Ermenonville, ces lieux admirables que le marquis de Lezay-Marnésia a vanté dans ces deux vers détestables (12) :
